À partir de quelle somme un huissier intervient ?

Lorsque vous êtes confronté à une dette impayée, que vous soyez créancier ou débiteur, il est essentiel de comprendre à partir de quel montant un huissier de justice peut intervenir. Ce professionnel, désormais appelé commissaire de justice, représente souvent la dernière étape avant une exécution forcée.
Commandement de payer : comprendre la procédure légale
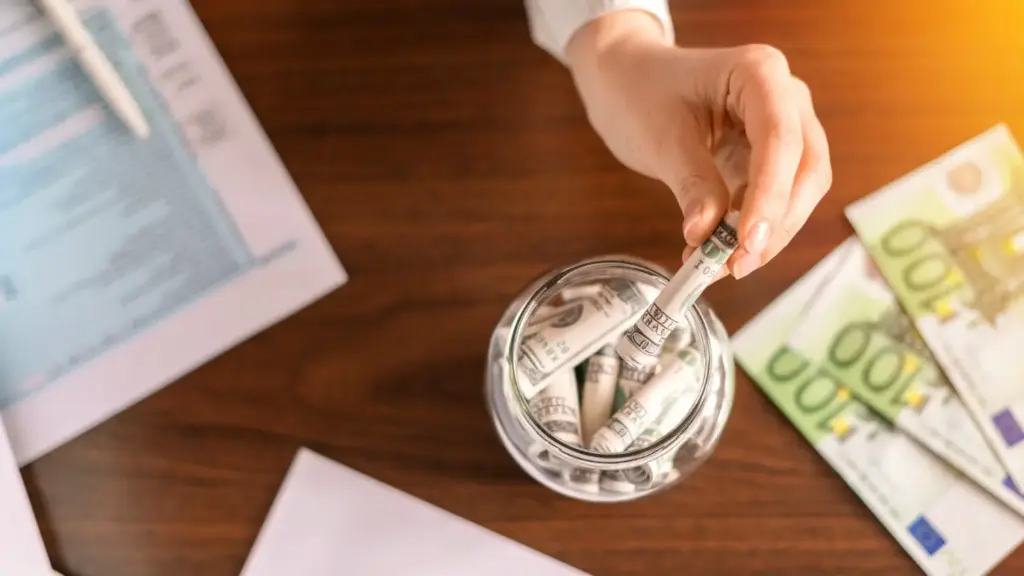
Le commandement de payer est un acte juridique essentiel dans la gestion des loyers impayés et la procédure d’expulsion d’un locataire. Cette démarche, généralement initiée par un bailleur en cas de retards de paiement, a pour objectif de récupérer les sommes dues et, si nécessaire, d’obtenir la résiliation du bail ainsi que l’expulsion du locataire. Il est important de comprendre les étapes et les implications de ce processus, tant pour les propriétaires que pour les locataires, car il peut avoir des répercussions importantes sur les relations locatives et la situation financière des parties concernées.
Calcul surface mètre carré (m2) : Simulateur calcul de surface

Calculer la surface habitable d’un logement est essentiel, que vous soyez propriétaire, acheteur ou simplement curieux des dimensions de votre espace. Ce calcul, exprimé en mètres carrés (m²), influence la valeur de votre bien, les taxes à payer et votre perception de l’espace disponible.
La surface habitable, encadrée par des lois comme la loi Carrez en France, doit être mesurée avec précision pour éviter erreurs juridiques ou financières. Il est important de connaître les méthodes de calcul, les types de surfaces concernés, ainsi que les pièces à inclure ou exclure.
Loi Carrez : Tout Savoir sur Le Mesurage Immobilier

La loi Carrez est une réglementation clé dans l’immobilier français, particulièrement pour les transactions de logements en copropriété. Elle garantit une transparence essentielle en imposant le calcul précis de la superficie privative d’un bien.
Grâce à cette loi, les vendeurs doivent fournir une mesure exacte de la surface habitable, excluant les espaces de moins de 1,80 m de hauteur sous plafond et les balcons. Cela permet d’éviter les litiges et malentendus entre acheteurs et vendeurs
Loi Boutin : obligations pour calculer la surface habitable

La loi Boutin, essentielle pour les propriétaires et locataires, régule le marché immobilier en garantissant transparence et équité. Elle se concentre principalement sur la détermination de la surface habitable d’un logement, une donnée dans les transactions immobilières.
Cette réglementation est souvent mentionnée dans les baux de location et les annonces immobilières, car elle définit les règles pour calculer précisément la surface habitable. Comprendre ces obligations est indispensable pour naviguer efficacement dans le monde de l’immobilier.
Classement meublé de tourisme : quels inconvénients ?

Le classement d’un meublé de tourisme présente des avantages, comme des avantages fiscaux et une attestation de qualité pour séduire les locataires. Cependant, il comporte aussi des inconvénients à considérer avant de prendre une décision. Parmi eux, on retrouve des règles strictes à respecter, l’interdiction des locations longue durée, une gestion administrative complexe, des frais de classement à prévoir, et une fiscalité parfois moins avantageuse selon votre profil.
Paiement à terme échu ou paiement à échoir ? Définition

Cet article vise à éclaircir ces deux concepts, en abordant leurs définitions, avantages, inconvénients, et leur impact sur les parties concernées, en particulier dans les contextes de location ou de prestation de services.
Saisir la nuance entre ces modalités de paiement est vital pour une gestion financière efficace, éviter les quiproquos, et favoriser des décisions éclairées, que vous soyez locataire, entrepreneur, ou bailleur.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : Droits et obligations locatives

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, connue sous le nom de loi Mermaz, joue un rôle important dans la gestion des relations bailleurs-locataires en France. Instaurée il y a plus de trente ans, elle cherche à équilibrer les droits et devoirs des deux parties dans un contrat de bail pour les logements, offrant sécurité aux locataires et protégeant les propriétaires. Avec l’introduction de la loi ALUR en 2014, la loi du 6 juillet 1989 a été mise à jour, élargissant ses règles aux locations meublées dans l’application du code locatif. Ce guide explique ses principes, règles, obligations, ainsi que les droits et protections pour locataires et bailleurs. Indispensable pour les propriétaires et locataires, cette loi facilite la navigation dans le complexe marché des logements immobiliers français, en détaillant ses aspects pour une meilleure compréhension et application des normes d’habitation. Qu’est-ce que la loi 89-462 du 6 juillet 1989 : de quoi s’agit-il ? La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aussi connue sous le nom de loi Mermaz-Malandain, est une législation fondamentale qui réglemente les relations locatives dans le secteur privé. Elle vise à établir un équilibre entre les droits et obligations des bailleurs et des locataires, assurant ainsi une certaine sécurité et stabilité pour les deux parties selon les articles du code locatif. Cette loi comprend un ensemble de dispositions couvrant divers aspects des contrats de location, incluant la durée du bail prévue par décret, le montant du loyer, les conditions d’usage et de préavis de congé, le dépôt de garantie, ainsi que les diagnostics techniques obligatoires pour les logements mis en location. Les principaux droits des locataires selon la loi du 6 juillet 1989 La loi du 6 juillet 1989 accorde plusieurs droits importants aux locataires pour garantir leur protection et leur confort dans le logement et selon le contrat de location, notamment : Les devoirs des locataires selon la loi du 6 juillet 1989 En complément des droits, la loi définit également plusieurs devoirs incombant aux locataires pour garantir le bon usage et l’entretien du logement, tels que : Les règles de location régies par la loi de 1989 La loi du 6 juillet 1989 établit un cadre réglementaire détaillé pour les locations d’habitation, visant à protéger les droits principaux des locataires et des bailleurs. Voici les aspects clés : Les droits et obligations du propriétaire imposées par la loi Mermaz Les obligations du locataire (article 7) La loi du 6 juillet 1989 précise les devoirs du locataire pour assurer une utilisation responsable et respectueuse de son logement. Voici les obligations principales à respecter : Les droits du locataire Instaurée par la loi du 6 juillet 1989, une protection renforcée est offerte aux locataires, assurant leur bien-être et sécurité au sein de leur logement. Explorons les droits fondamentaux conférés aux locataires : Chaque locataire jouit du droit à un usage paisible de son logement, ce qui implique une protection contre les nuisances et troubles de voisinage susceptibles d’entraver son quotidien. Il incombe au bailleur de s’assurer que le logement ne soit pas source de gêne excessive pour les voisins. Le décès du locataire permet aux ayants droit de résilier le contrat de location, sous conditions spécifiques. L’abandon du domicile par le locataire autorise le bailleur à résilier le bail et à réclamer des dédommagements. Toutefois, des protections sont prévues pour les ayants droit et colocataires, leur permettant de demeurer dans le logement selon certaines modalités. Les locataires sont autorisés à effectuer des travaux et réparations mineurs pour améliorer leur habitat, à condition de respecter les normes et obligations légales. Il est nécessaire d’informer le bailleur de ces travaux et d’obtenir son consentement pour toute modification majeure. Les embellissements et améliorations de confort sont habituellement permis, à condition de préserver l’état initial du logement. # La sous-location La sous-location est généralement interdite, sauf autorisation écrite du bailleur. En l’absence d’accord, le bailleur peut résilier le bail principal. Le sous-locataire peut être considéré comme occupant sans droit ni titre et risque l’expulsion. Le locataire principal s’expose à la perte de son droit au renouvellement du bail, voire à l’expulsion. # La colocation La colocation est permise, avec plusieurs individus signant un même contrat de location. Les colocataires sont conjointement responsables des obligations locatives, incluant le paiement du loyer, des charges et l’entretien du logement. Des règles spécifiques régissent la colocation, notamment concernant la résiliation du bail et les obligations des colocataires. Les litiges et contentieux (article 20 et 20-1) La loi du 6 juillet 1989 met en place des procédures pour régler les désaccords entre bailleurs et locataires de façon juste et efficace. Ces procédures sont détaillées dans les articles 20 et 20-1 de la loi Mermaz. Voici un aperçu des options disponibles pour résoudre les litiges : La commission départementale de conciliation En cas de litige, les parties peuvent faire appel à la commission départementale de conciliation, comme le prévoit l’article 20. Cette commission vise à encourager un règlement amiable entre le bailleur et le locataire. Il n’est pas obligatoire de passer par cette commission avant de faire appel à la justice, mais cela est vivement conseillé pour essayer de trouver une solution à l’amiable. Le recours au juge Si un accord amiable n’est pas trouvé via la commission, les parties peuvent se tourner vers le juge des contentieux de la protection. Ce dernier peut être sollicité pour divers problèmes, tels que des demandes de mise en conformité du logement, de réduction de loyer, ou de résiliation de bail. Le juge détermine alors les travaux nécessaires et fixe un délai pour leur réalisation. Il a également le pouvoir de réduire le loyer ou de suspendre son paiement, avec ou sans consignation, ainsi que de suspendre la durée du bail jusqu’à ce que les travaux soient effectués. Mise en conformité du logement Si le logement ne respecte pas les critères de décence et de performance énergétique mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut exiger sa mise en conformité. En cas de
Qu’est ce qu’un appel de fond ?

Être copropriétaire ou envisager d’acheter un bien en copropriété implique de connaître l’importance de l’appel de fonds. Cette demande de paiement, faite par le syndic, vise à financer l’entretien et la gestion de l’immeuble, essentiels pour maintenir en bon état les espaces et équipements partagés. Nous décryptons ici tout ce qu’il faut savoir sur l’appel de fonds : de sa signification, aux types d’appels, en passant par le calcul des charges et les obligations de paiement. Découvrez le rôle du syndic et les responsabilités qui incombent aux copropriétaires dans le maintien de leur investissement immobilier. Qu’est-ce qu’un appel de fonds en copropriété ? Un appel de fonds en copropriété représente une sollicitation de paiement envoyée par le syndic de copropriété aux propriétaires des lots. Cette requête a pour but de financer les dépenses liées à la gestion courante, l’entretien et la préservation des propriétés partagées. Indispensables, ces appels de fonds permettent de couvrir des coûts variés, depuis les charges habituelles jusqu’aux travaux exceptionnels. Les charges habituelles englobent l’entretien des espaces communs, comme le nettoyage des entrées et des escaliers, le soin des jardins, ainsi que le salaire du personnel de maintenance et l’achat des produits d’entretien. Elles incluent également les frais administratifs, par exemple les honoraires du syndic, les assurances du bâtiment, et les dépenses pour les services collectifs tels que l’éclairage et le chauffage des aires partagées. Par ailleurs, les appels de fonds peuvent aussi concerner des travaux spécifiques comme les réparations importantes, les améliorations ou les modifications structurelles du bâtiment. Ces interventions peuvent viser à maintenir ou à améliorer l’immeuble, ses équipements communs, ou à réaliser des études techniques pour des améliorations futures. Il est important de souligner que le montant des appels de fonds est déterminé à partir d’un budget prévisionnel annuel, élaboré et approuvé par les copropriétaires en assemblée générale. Ce budget énumère toutes les dépenses anticipées pour l’année suivante, permettant ainsi une répartition équitable des charges parmi les copropriétaires, en fonction de leur part dans les parties communes de l’immeuble. Les différents types d’appels de fonds Appels de fonds pour charges générales Les appels de fonds pour charges générales représentent la forme la plus répandue de contribution financière au sein d’une copropriété, destinée à couvrir les dépenses habituelles. Ces charges se divisent en deux catégories principales : les charges courantes et les charges spéciales. Les charges courantes englobent les frais nécessaires au maintien et à l’entretien de l’immeuble, incluant les travaux mineurs de rénovation, la maintenance des installations, l’entretien des zones communes et des jardins, ainsi que le salaire du personnel tel que les gardiens ou concierges. Elles couvrent également les coûts administratifs, tels que les honoraires du syndic de copropriété, les assurances de l’immeuble, et les dépenses liées aux services collectifs comme l’électricité et le chauffage dans les parties communes. Quant aux charges spéciales, elles sont calculées selon un barème spécifique basé sur l’utilisation des équipements par chaque copropriétaire. Ainsi, l’usage de l’ascenseur ou du parking entraîne des frais supplémentaires pour les résidents concernés, tandis que ceux qui n’utilisent pas ces services ne sont pas facturés. Appels de fonds pour charges exceptionnelles Les appels de fonds pour charges exceptionnelles visent à financer des dépenses imprévues, non incluses dans le budget initial. Ces situations d’urgence peuvent compromettre la sécurité des résidents ou l’intégrité de l’immeuble, nécessitant une intervention rapide. Elles peuvent inclure, par exemple, le remplacement urgent d’une chaudière en période hivernale, des travaux pour restaurer l’étanchéité d’une toiture défectueuse, ou la réparation d’un mur en danger de s’effondrer. Ces appels de fonds sont initiés lors d’une assemblée générale extraordinaire, convoquée en urgence, où les copropriétaires décident de la réalisation des travaux et des modalités de financement. Appels de fonds pour travaux Cette catégorie d’appels de fonds concerne les projets d’ampleur, tels que la rénovation de façades, la réfection de toitures, ou la mise en conformité des installations électriques. Ces travaux, de par leur envergure, requièrent un budget conséquent et sont planifiés lors de l’assemblée générale des copropriétaires. Le financement de ces travaux est anticipé dans le budget prévisionnel, qui estime les dépenses pour l’année à venir, y compris pour ces gros travaux, et répartit le coût total entre les copropriétaires selon leur quote-part. Appels de fonds exceptionnel Les appels de fonds exceptionnels concernent des demandes de financement spécifiques pour des dépenses non prévues ou des projets majeurs nécessitant des fonds supplémentaires. Ces demandes sont formulées par le syndic de copropriété et doivent être validées par les copropriétaires lors d’une assemblée générale. Les circonstances pouvant déclencher de tels appels incluent des rénovations importantes non anticipées, des réparations urgentes à la suite de dommages, ou un déficit budgétaire résultant d’une gestion déficiente ou de retards de paiement. Les conditions de paiement, y compris les échéances, doivent être clairement établies lors de ces appels. Quelles charges peuvent faire l’objet d’appels de fonds ? Les charges courantes représentent les dépenses régulières nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal de la copropriété au quotidien. Elles comprennent les frais de gestion, comme les honoraires du syndic, les primes d’assurance de l’immeuble, ainsi que les coûts liés aux services collectifs, tels que l’électricité et le chauffage des parties communes. Ces charges couvrent également l’entretien des espaces communs, incluant le nettoyage des halls et couloirs, la maintenance des ascenseurs, et les services de sécurité. Les charges spéciales se rapportent aux équipements ou services spécifiquement utilisés par certains copropriétaires. Ainsi, les résidents profitant de l’ascenseur ou du parking sont facturés pour leur entretien et maintenance, contrairement à ceux qui n’utilisent pas ces services. La répartition de ces charges est basée sur l’utilisation effective de chaque service. Les appels de fonds pour travaux visent à financer des projets importants comme la rénovation de la façade, la réfection de la toiture, ou la mise aux normes des installations électriques. Ces travaux, généralement prévus et votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires, sont inclus dans le budget prévisionnel annuel. La provision pour ces travaux doit être au moins équivalente à 5% du budget prévisionnel de la
Garantie Visale, c’est quoi ? Guide pour comprendre et bénéficier

La garantie visale c’est quoi ? Vous recherchez un logement ou êtes propriétaire bailleur ? La garantie Visale pourrait vous intéresser. Créée par Action Logement, elle vise à faciliter l’accès au logement, surtout pour les jeunes et les salariés sans garanties financières suffisantes. Cette garantie gratuite, qui succède à la GRL (Garantie des Risques Locatifs), propose une approche innovante pour sécuriser les locations. Dans cet article, découvrez les détails de la garantie Visale : son objectif, les bénéficiaires, la procédure pour l’obtenir, et ses avantages ainsi que ses inconvénients. Que vous soyez locataire ou propriétaire, la garantie Visale pourrait être la solution qu’il vous faut. Garantie visale c’est quoi ? La garantie Visale est un dispositif de cautionnement gratuit, géré par Action Logement, visant à faciliter l’accès au logement pour les locataires et à sécuriser les transactions entre locataires et bailleurs. Ce dispositif est particulièrement destiné aux individus qui rencontrent des difficultés à trouver un logement en raison de l’absence de garanties financières suffisantes. Que couvre la garantie Visale ? La garantie Visale couvre plusieurs aspects importants des relations locatives, notamment en cas d’impayés de loyer pour une durée pouvant aller jusqu’à 36 mois, sans franchise ni délai de carence pour le bailleur, y compris pour les étudiants et alternants. De plus, cette garantie prend en charge les dégradations locatives causées par le locataire, mais uniquement pour les logements du parc privé et à hauteur de 2 mois de loyer charges comprises, pour les contrats souscrits à partir du 1er février 2019. Visale : Facilitation de l’accès au logement Cette garantie gratuite joue un rôle important en facilitant l’accès au logement pour les jeunes, les salariés en situation précaire, ou en mobilité professionnelle, en offrant une alternative sécurisée au dépôt de garantie physique. Elle permet au locataire de présenter un dossier plus rassurant pour le propriétaire, renforçant ainsi les chances de trouver un logement plus facilement. Aucune caution personnelle requise pour le locataire Le dispositif Visale dispense les locataires de présenter une caution personnelle ou bancaire, facilitant considérablement l’accès au logement sans avoir à payer de garanties supplémentaires. Cela remplace avantageusement d’autres dispositifs de garantie tels que la GRL, en réduisant les risques pour le locataire et le bailleur. Une assurance contre les loyers impayés au service du bailleur La garantie Visale offre une protection significative aux bailleurs, garantissant le remboursement des loyers impayés pour une durée de jusqu’à 36 mois, sans franchise ni délai de carence. Cette couverture étendue rassure les propriétaires et protège contre les risques financiers liés à la location. Une protection efficace contre les dégradations locatives Depuis le 1er février 2019, la garantie inclut également une couverture contre les dégradations locatives, obligeant le locataire à établir un état des lieux précis à l’entrée et à la sortie du logement. Cette protection est valable pour les logements du parc privé, couvrant jusqu’à 2 mois de loyer charges comprises. Qui peut bénéficier de Visale ? Quels sont les locataires concernés par la garantie Visale ? La garantie Visale est accessible à un large éventail de locataires, y compris les jeunes de 18 à 30 ans, les étudiants, les alternants, les salariés en situation de précarité ou en recherche d’emploi, et les autoentrepreneurs, répondant à diverses conditions. Depuis le 4 juin 2021, tous les salariés percevant jusqu’à 1 500 euros nets par mois, sans limite d’âge, y compris ceux embauchés depuis moins de six mois, en mobilité professionnelle, ou avec une promesse d’embauche de moins de trois mois, sont également éligibles. Les ménages logés par un organisme d’intermédiation locative et ceux éligibles au bail mobilité peuvent aussi bénéficier de cette garantie. Quels types de logements sont éligibles à la garantie Visale ? La garantie Visale s’adresse à une large gamme de logements, couvrant à la fois les logements nus ou meublés, loués par des propriétaires privés ou des organismes. Pour être éligibles, ces logements doivent respecter certaines conditions, notamment être la résidence principale du locataire et se conformer aux normes de décence et de sécurité. Les structures collectives, telles que les foyers reconnus au sens de l’article L.633-1 du CCH, les résidences étudiantes ou universitaires, sont éligibles pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. De plus, les logements situés dans le parc social, gérés par des organismes HLM ou SEM, ainsi que les logements conventionnés APL, s’ouvrent aux étudiants ou alternants dans la même tranche d’âge. Il est important de souligner que pour bénéficier de cette garantie, le loyer charges comprises du logement ne doit pas dépasser 1 300 euros hors Île-de-France, et 1 500 euros dans cette région. Comment obtenir la garantie Visale ? La procédure pour obtenir la garantie Visale comporte plusieurs étapes clés que doivent suivre le locataire et le bailleur. Ce guide vise à simplifier votre parcours à travers ce processus. Étape 1 : Faire une demande de garantie Visale en ligne Le locataire doit d’abord créer un compte personnel sur le site officiel de Visale, visale.fr. Il est conseillé d’effectuer cette démarche avant de débuter la recherche d’un logement, afin d’optimiser vos chances de succès. Après la création de l’espace personnel, le locataire a 15 jours pour finaliser son dossier, en fournissant des documents tels que : Étape 2 : Attendre la décision d’Action Logement Une fois le dossier soumis et complet, Action Logement examine la demande et, en cas d’acceptation, émet un visa certifié en quelques jours, à l’exception des week-ends et jours fériés. Étape 3 : Fournir le visa au propriétaire Le locataire doit ensuite télécharger le visa certifié depuis son espace personnel sur Visale et le présenter au bailleur. Ce document inclut des informations essentielles comme le nom du locataire, le montant maximal du loyer couvert, et la période de validité du visa. Étape 4 : Demander un contrat de cautionnement Le bailleur, de son côté, doit créer un compte sur Visale, entrer les détails du locataire et du visa, puis signer électroniquement le contrat de cautionnement. Cette formalité accomplie, le contrat de location peut être officiellement signé
